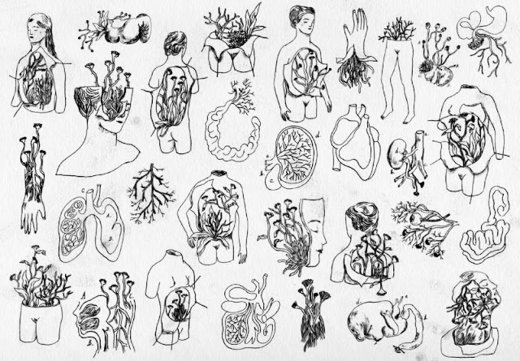CA 333 octobre 2023
Santé : le pari de l’autonomie.
mercredi 18 octobre 2023, par
Le mouvement féministe entretient une difficile contradiction face à l’institution médicale. On ne compte plus les dénonciations « d’abus » de pouvoir de la part de médecins alors que dans le même temps se multiplient les tribunes réclamant une meilleure prise en charge, des recherches de pointes et des traitements pour quelques-unes des maladies dont nous souffrons. Nous rejetons l’idéologie médicale, mais sommes dépendantes de ses techniques : l’institution médicale nous malmène mais les recherches ainsi que certains traitements qu’elle produit nous aident également. Alors que faire ? S’en détacher et « faire nous-mêmes » ? Le mouvement du self-help a tracé une voie enthousiasmante : il nous donne un aperçu de ce que pourraient être des soins médicaux dans un système dans lequel on ne répond pas à nos besoins au prix de notre dignité. Mais il est réservé à quelques-unes, celles qui ont le temps d’apprendre ces connaissances et de les partager… Dans le même temps, en France et ailleurs, des millions de femmes se battent pour bénéficier des soins de base. Elle est là, la pierre d’achoppement : nous voulons toutes avoir accès à des soins de qualité, quand nous l’estimons nécessaire, mais nous voulons y avoir accès à nos conditions, sans être à la merci du pouvoir médical reposant sur la maitrise des compétences de soins par quelques personnes seulement. Cette voie de traverse est peut-être impraticable, mais je vais tout de même essayer de débroussailler un peu le chemin en résumant ici des idées longuement développées par ailleurs (1) pour tenter de proposer une critique du pouvoir médical qui participe à en saper les fondations idéologiques et matérielles, en les rendant conscientes.
La définition du pouvoir retenue ici est la suivante : c’est la possibilité, de la part d’une personne ou d’un groupe à la poursuite de ses propres intérêts de restreindre d’autres personnes ou groupes dans le choix de leur conduite. Le pouvoir dépossède individus et collectifs de leur capacité à décider pour eux-mêmes : qu’il soit conscient ou non, il implique une destruction de l’autonomie des individus.
Le pouvoir médical est l’apanage d’une élite qui dispose du monopole légal de l’exercice de la médecine. Il repose sur un rapport de classe (au vu de l’extraction sociale des médecins, il y a la plupart du temps un grand écart socio-culturel avec les soignés), et sur la rétention du savoir médical au profit des seuls initiés. Comme le pouvoir religieux en son temps, le pouvoir médical craint de voir une autorité concurrente s’élever contre lui : il ne peut s’exercer pleinement qu’en faisant de ses prêtres les détenteurs d’un savoir inaccessible aux profanes. Tout transfert de savoir vers la société engendrerait des débats et des discussions qui se transformeraient sans doute en critique des compétences, ce que les médecins ne peuvent accepter, eux qui justifient leur position et leurs privilèges justement par leur compétence (réunion de savoirs et de savoirs faires).
Le pouvoir médical repose sur le mythe de la toute-puissance du savoir scientifique… dont le médecin est dépositaire : il est donc couramment perçu comme étant la seule personne qui puisse libérer le patient de la souffrance, voire de la mort. Mais ce pouvoir est bien souvent surfait, car la médecine gère les conséquences des maladies (les symptômes) plus qu’elle ne soigne leurs causes, que celles-ci soient organiques, psychologiques ou sociales.
Enfin, le système médical est une industrie de service, prise dans un marché. Les soins sont des marchandises, les patients en sont les consommateurs. Les médecins jouent dans cette distribution le rôle essentiel : ils accélèrent la consommation et contribuent à détourner vers les intérêts privés l’énorme budget dont ils contrôlent l’usage. En tant que principaux ordonnateurs des dépenses de santé, ils disposent donc d’un pouvoir économique.
Parmi toutes les institutions qui norment la société industrielle et huilent les rouages du capitalisme, le pouvoir médical tient bonne place : le système médical est en effet la seule autorité pour déterminer qui est en bonne santé, qui est malade, qui est adapté et qui ne l’est pas.
La médecine du travail ne joue pas le rôle de protection des travailleurs que ceux-ci seraient en droit d’attendre d’elle et, pieds et poings liés à l’entreprise (son employeur direct, ou son payeur), ses recommandations sont rarement suivies d’effet si elle s’avise de demander l’adaptation d’un poste de travail. En dehors même du lieu de travail, et alors même que les besoins de santé des gens exigeraient une refonte globale des modes de production, la seule réponse du corps médical est de participer au développement de la consommation de soins et de médicaments… Chaque année en France, ce sont 17 millions de prescriptions d’anxiolytiques qui ont lieu : voilà la réponse apportée, par médecin interposé, au malaise des individus par rapport à la vie sociale, c’est-à-dire à des soucis humains, des problèmes de vie quotidienne, dans et hors travail, qui dégradent la santé.
En échange de privilèges économiques et sociaux et d’un statut particulier, le corps médical dans son ensemble ferme les yeux, de manière inconsciente probablement, sur son rôle : la réinjection des travailleurs dans le système de production après les soins. Il se pose comme étant en mesure de classer, comprendre et traiter individuellement les faillites de la société, sans la moindre tentative de remise en cause : cela témoigne de sa collaboration/collusion avec la classe dirigeante, et d’un besoin de conserver sa domination telle quelle. Il cautionne donc l’ordre ambiant et établit des normes sociales au même titre que d’autres corps constitués (juges, enseignants, prêtres en leur temps) : au niveau de la collectivité, il en résulte que les médecins, qui ne composent qu’un petit groupe de personnes, peuvent imposer au plus grand nombre des discours, des schémas d’idées et des modèles de comportements, non seulement dans le domaine de la santé, mais aussi dans tous les domaines de la vie sociale. L’institution médicale est un puissant instrument de contrôle social qui porte sur l’ensemble des individus.
Le pouvoir médical s’exerce directement sur les individus lors du rendez-vous chez le médecin, le « colloque singulier » défini comme la « rencontre entre une confiance et une conscience » … Mais ne s’agit-il vraiment que d’une rencontre entre deux personnes ? Loin de là, le colloque singulier est aussi (surtout !) une relation de classe. Le langage employé, volontiers jargonneux et incompréhensible au profane, véhicule une domination symbolique. Le médecin ne fournit que peu d’explications, mais rappelle volontiers les sanctions qui s’abattront sur le patient en cas de désobéissance à ses ordres (la prescription) : « vous lui donnerez ses vitamines tous les jours sans faute, sinon il aura les jambes fragiles » ; « je ne vous prescrirais cet examen que si vous prenez tel médicament », etc. Le médecin se pose ainsi comme le seul dépositaire des mots et de la technique de guérison. Il est admis qu’il soit le seul à pouvoir intervenir afin de soulager le corps du patient, et par son langage particulier, il impose le silence et empêche le patient de prendre en charge sa maladie ou de la nommer.
Dans le courant des décennies porteuses d’un espoir d’émancipation qu’ont été les années 60 et 70, la critique du système de soin et du pouvoir médical ont été faites en actes et en mots. Chez Illich, dans la Némésis médicale (1975), on retrouve une critique radicale de la finalité même de l’institution médicale : la thèse défendue dans son essai est que loin d’améliorer la santé, elle la compromet en développant la morbidité générale par différents processus imbriqués qu’il nomme « iatrogenèse », empruntant au vocabulaire médical ce mot recouvrant les maux causés par la médecine. Sa théorie me semble toujours féconde pour comprendre pourquoi nous ne parvenons pas à aller mieux malgré (à cause de ?) la médicalisation croissante de nos vies.
Il propose que notre médecine moderne rende malade à plusieurs niveaux :
- par une iatrogenèse clinique d’abord : il critique de manière systématique la compétence et le bien-fondé mêmes des activités du corps médical, en raison de la morbidité associée à nombre d’actes hautement techniques, dangereux et onéreux, pas toujours nécessaires, parfois pires que le mal ;
- par une iatrogenèse sociale ensuite, comprise comme un développement pour les individus de la dépendance à l’acte médical, et la perte de la capacité de s’adapter à notre environnement et de refuser des environnements intolérables par des actes personnels ;
- par une iatrogenèse structurelle enfin, en entretenant l’idée selon laquelle la suppression de la douleur, du handicap et le recul indéfini de la mort sont des objectifs désirables et réalisables, des fléaux qui peuvent être combattus par des moyens purement techniques, grâce au progrès du système médical. Cette idée se développant compromet la capacité autonome des gens à faire face à la douleur, à l’infirmité et la mort en leur donnant un sens.
Ces deux dernières causes de mal-être ne sont que les deux volets d’une même réalité : la médecine moderne, de par son caractère technique, transforme la personne en objet qu’on manipule, en patient qui subit et abandonne à d’autres la prise en charge de son corps, éventuellement de son esprit. Elle lui refuse la liberté de choisir, de décider, c’est-à-dire d’être une personne autonome. La douleur devient quelque chose d’extérieur à soi, dont faut se débarrasser, et devant elle, c’est la libération dont on pense qu’elle sera octroyée par l’institution médicale que l’on recherche : par ce processus, les gens perdent leur capacité à s’adapter à leur milieu, de posséder la santé conçue comme « la capacité de faire face de façon active au milieu et aux aléas de la vie ».
Commencez à critiquer le bien fondé de tel diagnostic, de telle prise en charge… ou comme l’a fait Illich, la médecine en tant que telle, et vous verrez la communauté médicale s’insurger d’un seul homme en défendant les victoires presque « miraculeuses » qu’elle obtient (opérations héroïques le plus souvent, mais aussi éradication de certaines souches pathogènes). Pourtant, si l’on est d’accord qu’il ne faut pas nier les succès de la médecine, il faut pouvoir s’interroger sur leur signification à l’échelle collective : les effets de ces avancées spectaculaires sont très limités en comparaison de tous les problèmes collectifs auxquels la majorité du corps médical est aveugle – ou face auxquels il est impuissant. Sauf rare exception, les médecins ignorent les problèmes de santé publique et d’épidémiologie. Et pour cause, ils sont formés à soigner un être abstrait et indifférencié, réduit à une catégorie biologique, en ignorant la dimension collective : il n’est jamais tenu compte de la classe sociale du patient, de ses activités, de son mode de vie et de son individualité.
Et pourtant ce sont nos rôles sociaux et donc l’environnement dans lequel on vit et travaille, l’hygiène, et non notre biologie, ou des facteurs médicaux, qui déterminent d’avance notre niveau de santé. Mais sans outils statistiques pour les comprendre, sans études épidémiologiques, la médecine nous présente notre état de santé comme l’expression d’une fatalité biologique causée par notre sexe, notre âge… ou une cause génétique, comme il est à la mode en ce moment.
Si l’on peut affirmer avec Illich que « tous les âges sont médicalisés, tout comme le sexe, le quotient intellectuel ou la couleur de la peau », il est un groupe qui l’est systématiquement : celui des femmes. Nous sommes perçues par le corps médical comme des êtres naturellement malades et toutes les étapes de notre vie sont maintenant médicalisées, faisant de nous des patientes à vie : de nos premières règles qui surviennent trop tôt ou trop tard (hop ! premier rendez-vous chez le gynéco), à la ménopause, forcément invalidante si nous avons encore l’âge de bosser, en passant par les règles…
L’idéologie médicale véhicule un sexisme profondément enraciné dans la société, sans le créer toutefois. La domination masculine n’a pas attendu son avènement pour exister (2), elle qui a toujours doublé la domination bien matérielle de mythes (3) pour justifier son existence. La médecine fait ici figure de mythe moderne : elle ne fait que reformuler le sexisme en ses termes, ceux de la biologie et de l’évolution, et en cela en est l’un des maillons actuels de la domination masculine. L’idéologie médicale récente nous a tour à tour présentées comme hystériques à traiter, petites choses fragiles à soigner (clientes bourgeoises fortunées) ou contagieuses et porteuses de maladies vénériennes (femmes des classes populaires, leur « traitement nécessaire » causant l’essor de la santé publique au XIXe). Au fil des siècles précédents, nous sommes passées du statut d’être maladifs qu’il faut choyer et contenir à la maison, à celui de travailleuses développant moins de maladies que les hommes, mais patientes stupides et auto-complaisantes. De sorte que quand les médecins ont un souci pour identifier une cause organique, ils nous renvoient fréquemment à des raisons psychosomatiques, ce qui mène à des approches irrationnelles et des traitements inefficaces. Nous arrivons malade chez le médecin, et ressortons du cabinet en nous sentant folles… La tendance des médecins à déterminer que nos affections sont d’origine psychosomatiques montre que la perception médicale des femmes n’est pas passée de « malade » à « en bonne santé », elle passée de « physiquement malade » à « psychologiquement malade ». Le carcan idéologique dans lequel la médecine moderne s’est construite est particulièrement préjudiciable à la santé des femmes en particulier, nous avons donc un intérêt tout particulier à nous autonomiser quant à notre santé.
Il est clair désormais que l’institution médicale dont il a été question tout au long de cet article empêche les individus d’être autonomes quant à leur santé. Elle les dépossède des connaissances médicales qui leur permettraient de prendre en charge les maux les plus courants, elle leur enseigne à ne voir de salut que dans la recherche d’un soulagement extérieur, au sein de l’institution médicale, dans la recherche scientifique. Elle participe à créer une certaine passivité et accompagne bien une société dans laquelle les gens sont formatés à obtenir les choses plutôt qu’à les faire. Elle annihile le réflexe d’évitement des situations qui nous rendent malades, les possibilités de les remettre en cause et de les modifier radicalement (comprendre : une bonne grève a minima, au mieux une bonne révolution) tant elle place la santé sur le plan individuel.
A rebours d’une conception de la santé comme un service produit (soulagement extérieur à soi) par des médecins et consommé par des patients, on peut suivre Illich dans sa proposition de considérer que la santé serait la faculté de faire face de façon active et d’être autonome vis-à-vis des aléas de la vie. Cette conception, active, de la santé, me permet de revenir, après un long détour par les fondements du pouvoir médical, sur la tension exposée initialement entre le « faire soi-même » et la lutte pour l’amélioration de la manière dont les soins sont effectués dans notre système.
Dans l’état actuel des choses, la question de fond est toujours la même : qui décide des perspectives qui nous sont offertes ? Qui contrôle l’environnement social ? (cf Encadré sur le congé menstruel). Exiger une amélioration de la prise en charge médicale dans les conditions actuelles me fait grimacer, tant l’état de « santé » des personnes est relié à d’autres structures qu’il faudrait modifier toutes ensembles pour pouvoir changer la vie de tous et toutes. Nous ne décidons de rien, dans ce cadre, et tout ce que nous avancerons comme argument pour modifier les choses sera systématiquement retourné contre nous pour servir les intérêts des patrons : concernant le cas particulier qui nous occupe, dites que les femmes ont souvent des règles douloureuses, et sans essayer de comprendre pourquoi, et si cela est particulier à certains environnements de vie plus qu’à d’autres, nous serons discriminées à l’embauche. Dites que nous sommes aussi fortes que les hommes, et nous serons au turbin à plein temps. L’enjeu ici est toujours le même : qui propose, qui décide, qui applique ? La seule perspective d’exiger un meilleur système de soin est de souhaiter une dilution importante des compétences dévolues aux seuls médecins, que ce soit vers les autres professions paramédicales (sage femmes, infirmières, kinés… plus nombreuses que les médecins, mais aussi de différentes classes sociales) ou au sein de la société. Il parait important dans ce cadre de participer à la vulgarisation vraie des connaissances médicales, une vulgarisation qui se permet une critique des compétences pour dépouiller les médecins de leur statut.
Quant à l’autonomisation individuelle, il s’agit d’une opération tellement limitée qu’elle rend songeuse quant à sa capacité à modifier quoi que ce soit à l’échelle de la société. C’est pourtant en devenant alertes quant aux conditions dégradent notre santé que nous pourrons, collectivement, les remettre en cause et nous soulever face à la nécessité urgente de les changer. C’est en nous formant, en désacralisant le savoir médical, que nous pourrons réaliser quand des protocoles sont abusifs, non adaptés, pour exiger un véritable examen -par exemple, quand un médecin met une maladie organique sur le compte d’un dérèglement psychologique. Savoir et savoir-faire, devenir compétentes quant à la santé de manière générale, sont les garanties nécessaires pour défendre notre dignité. C’est sur ce principe d’autonomie qu’a reposé la plus importante remise en cause du système médical qui ait jamais eu lieu dans la décennie 70 par la création de centres de soins autogérés par les usagères (comme le Dispensaire des Femmes, créé en Suisse en 1978) ou par la pratique de l’avortement clandestin (avec le Mouvement pour la Libération de la Contraception et de l’Avortement). J’ose conclure en gageant que s’il y avait moins de médecine dans nos vies, il y aurait plus de révolutions, tant en remettant les gens au travail et en individualisant les problèmes de santé elle semble participer à la conservation de la structure actuelle de notre société.
Eloïse
Notes
(1) Dans les ouvrages suivants :
Le Pouvoir médical, François et Nicole Robin (1976), coll. Stock 2, ed. Stock
Némésis médicale, L’expropriation de la santé, Ivan Illich (1981), coll. Techno-critique, ed. Seuil
Une sorcière des temps modernes, Le self-help et le mouvement femmes et santé, Rina Nissim (2014), ed. Mammamélis
Fragiles et contagieuses, Le pouvoir médical et le corps des femmes, Barbara Ehreinreich, Deirdre English (texte original 1973), ed. Cambourakis (2016)
(2) Les sociétés passées, préhistoriques, ne sont pas un reflet d’un Eden perdu, exemptes de dominations masculine, de division du travail, de violence. Les sociétés humaines portent des traces culturelles de la domination masculine depuis au moins 70 000 ans, âge vers lequel Homo sapiens est sorti d’Afrique. Cf à ce sujet Le communisme primitif n’est plus ce qu’il était, Christophe Darmangeat (2012), Smolny…et la note suivante.
(3) L’un des mythes de justification du patriarcat est le mythe du matriarcat primitif, justification pour une société donnée d’un système de domination masculine par le retournement d’une hypothétique situation inverse (domination féminine ) antérieure. Il est présent depuis au moins 70 000 ans, cf. Cosmogonies, Julien d’Huy (2020), La Découverte.
Le congé menstruel
Le congé menstruel, qui défraye la chronique depuis les deux propositions de loi (écologiste et socialiste) faites au parlement il y a quatre mois de ça, est encore un exemple de concession, partielle, qui, n’étant pas décidée (ni même demandée) par les travailleuses, ne répondra pas correctement à nos attentes.
Délivré par les médecins, il nous soumettra encore à leur bon vouloir pour reconnaitre une douleur « incapacitante » et servira à masquer les défauts de diagnostic en cas de maladies telles l’endométriose. Aucune condition physiologique, normale, ne cause de douleurs de règles incapacitantes. Les règles ne sont pas quelque chose qui fait mal quand par ailleurs le corps va bien.
Du point de vue économique et politique, son financement est un moyen d’aider des entreprises désireuses de se parer d’une étiquette « féministe », les déchargeant de la prise en charge de ce congé et il ne participe pas à la suppression simple des jours de carence censés actuellement « responsabiliser » les travailleurs dans l’usage qu’ils font de la médecine.
Nous n’avons aucune maitrise collective sur la mise en place de ce congé, aucune perspective que cela change globalement la vie : c’est, encore, une adaptation afin de nous voir plus efficaces au travail… il n’y a qu’à en juger sur pièces : la proposition socialiste inclue la possibilité que ce jour de « congé » soit commué en jour de télétravail ! Là, c’est vraiment se foutre de notre gueule.
Alors on persiste et on signe : ce n’est pas d’un jour de congé mensuel en plus, dont nous avons besoin, mais d’arrêter de bosser et de maîtriser nos conditions d’activité et d’existence.